16 décembre
J’ouvre un œil vers 4 h puis vers 6h30. Il ne faut pas que je me rendorme.
Nous sommes contrôlés dans le train à l’aller.
J’embrasse Julien, je salue Marina, je salue Katy, j’embrasse Judith, je salue Inès, j’embrasse Camille.
Je me retrouve sur le port en début de matinée, après avoir accompagné E. à son stage. Je perdrais trop de temps à faire l’aller-retour jusqu’à la maison, aussi ai-je décidé de rester en ville et d’aller travailler à la bibliothèque. Sur le chemin, je croise des coureurs, à l’heure où je devrais moi-même être en train de courir, et je ne peux pas m’empêcher de les envier et de les jalouser un peu. Je me suis promis de courir ce soir.
En ville, la nouvelle tendance commerciale semble être aux cafés à valeur ironique ajoutée qui, tous, complètent leur raison sociale d’un petit adjectif qui témoigne de leur positionnement décalé : « café moderne », « bistrot créatif », « bar à copains ». Je ne doute pas de la bonne volonté de ces nouveaux tauliers, mais il n’empêche que ça a un petit côté agaçant.
Sur l’esplanade devant la médiathèque, des ferronniers découpent une sculpture d’aluminium dégradée, ça sent le métal chaud.
La première place choisie à bibliothèque n’est pas la bonne, je suis dans le passage d’un courant d’air et j’ai froid. Je change de place et cette fois je garde mon ciré.
Impossible d’envoyer ni de recevoir de mails, ça ne tombe vraiment pas la bonne semaine : j’ai plein de personnes à contacter et je ne serai pas chez moi.
Jambon-beurre pour E., Mozzarella-tomates séchées pour moi. 8€20 mais ils sont bons. Nous déjeunons sur le port, face aux tours. R. nous rejoint. Nous ne sommes pas plutôt assis qu’une mouette et un pigeon viennent collecter la dîme. Nous ne cédons pas. Un homme promène son lapin dans le square. Il ne quitte pas son carré d’herbe, alors qu’il aurait matière à s’égayer. Avant de quitter le square, l’homme essuie le dessous des pattes de son lapin sur l’écorce d’un pin. Docile le lapin.
Je salue Pier, de retour des Philippines, et qui se laisse pousser les cheveux. Un peu plus tard, je salue Marina, qui a toujours les cheveux tirés, et les traits aussi.
Nous avons un peu de temps à perdre avec E., nous allons passer devant notre ancienne maison. Tous les restaurants alentours ont changé, ils sont tous aux trois-quarts vides. Devant l’immeuble qui a brûlé il y a quelques jours en ville, à deux pas de notre ancien logement, quelques fleurs accrochées sur les barrières de protection et, sur une ardoise, une inscription, « Hommage à Muriel ».
J’entre dans la librairie. Je feuillette plusieurs livres dont j’avais noté la référence et, pour la plupart, je me dis « Ce n’est que ça. » Je ressors sans rien avoir acheté. Ça tombe bien, je n’ai pas de sous.
Il faudrait faire l’inventaire photographique de tous les revêtements minéraux de la ville : les sols, les murs, les toits.
Je photographie une boîte aux lettres éventrée, et la mâture du Belem, pour la seconde fois de la journée.

J’ai dans les mains A Descoberta do mundo, Crônicas, de Clarisse Lispector et je me demande si je suis encore capable de lire le portugais.
Il y a un côté assez plaisant à écrire à la bibliothèque. Les chuchotements des étudiants font comme un bruit d’eau, c’est plutôt apaisant. Chacun est devant son portable, l’ambiance est studieuse et je me prends à penser que je pourrais bien venir travailler ici plus régulièrement. Ce matin, je suis passé devant une annonce pour une place vacante dans un espace de coworking, au milieu d’architectes et de cartographes. 260 € mensuels TTC. L’idée m’a furtivement tenté puis je me suis dit que je ne serais pas à l’aise, qu’il y aurait une sorte d’injonction tacite à se montrer productif, à laquelle je ne veux surtout pas me soumettre, et surtout pas en payant. La bibliothèque c’est mieux. La seule chose qui pourrait me gêner, c’est l’impossibilité de téléphoner, ce qui est emmerdant pour mes interviews.
Après avoir annoncé à plusieurs contacts potentiels que j’ai un problème de mail et qu’il faut m’écrire sur une autre adresse, je résous mon problème de connexion, en changeant mon vieux mot de passe.
Dans la soirée, c’est mon appli de musique qui me demande de renoncer à ma plus vieille adresse encore en vigueur, qui visiblement ne répond plus : elle avait pour nom de domaine tele2.fr. Ça pose son homme.
Nous sommes contrôlés dans le train au retour.
Je cours 47 minutes, dont un bon quart au soleil couchant et une petite moitié éclairé à la lampe frontale. Je croise encore moins de monde à courir le soir que le matin, quel bonheur.
Purée de patates et carottes, steaks végés, clémentines.
Forcément, quand on sort, le linge s’entasse plus vite dans le bac.
17 décembre
Je me réveille en ayant l’impression d’avoir passé une bonne nuit, et même une très bonne nuit, ininterrompue.
Avec le premier café du matin, j’ouvre au hasard le bouquin de Clarisse Lispector posé sur la pile. Je lis :
Pois e eu que dormo tão mal, dormi de oito da noite até seis da manha. Dez horas : senti um orgulho pueril. Acordei com o corpo todo aumentado nas suas células. Ah, isso é vida normal, então ? mas então é muito bom !
(Moi qui dors si mal, j’ai dormi de huit heures du soir à six heures du matin. Dix heures : j’ai ressenti une fierté enfantine. Je me suis réveillée complètement régénérée. Alors c’est ça la vie normale ? mais c’est drôlement bien !)
Je peux encore lire le portugais, ça me rassure.
Je ne cours pas le mardi (de toutes façons, je n’ai pas le temps pour courir le matin, toute cette semaine.)
En attendant que tout le monde soit prêt à partir, je feuillette « Cher Cahier… témoignages sur le journal personnel« , de Philippe Lejeune, pour voir ce que les autres diaristes écrivent.
En passant devant un bistrot, sur le chemin de la gare, nous voyons un chien en train de lécher la condensation sur la vitrine, comme s’il était en train de laver le carreau.
Même si je me méfie du côté racoleur des slogans, certains m’arrêtent et m’amusent. Ainsi de

Un croissant : 1€40
A la bibliothèque, je lis :
Je ne lis pas beaucoup de récits de voyage. J’ai été marqué par ceux de Nicolas Bouvier et quelques autres, bien sûr. Mais je me méfie, du point de vue littéraire, de tout ce qu’il me semble y avoir d’assez prévisible dans le genre. Je n’ai pas grand goût pour la posture d’autohéroïsation dans laquelle il me semble qu’on peut vite tomber. J’avais très peur du côté « autoportrait en baroudeur » qui me guettait. Et en même temps, je voyais bien que je m’inscrivais, que je le veuille ou non, dans ce genre. J’ai donc cherché à inventer une forme autre. (Sylvain Prudhomme, dans Diacritik)
puis je lis :
Il ne bruinait plus quand je suis parti courir 35 minutes du côté du bois, et pendant que je courais avant ou après m’être dit qu’il fallait oublier le concept de linéarité dans la vie car la vie n’était pas linéaire mais dépendait de notre point d’entrée dans la vie, sans trop savoir d’ailleurs ce que ça voulait dire (…) (Guillaume Vissac, dans Fuir est une pulsion)
puis je lis :
Et si les souvenirs que nous gardons si précieusement dans notre mémoire étaient des merdouilles semblables à ceux qui s’alignent sur nos étagères ? (Eric Chevillard, dans L’autofictif)
J’envoie une rafale de mails pour des articles à venir depuis la bibliothèque, et j’arrive même à boucler un article. Et dire qu’à deux pas de ce fantastique espace de coworking, il y a un espace de coworking à 260€ mensuels.
J’embrasse Pascal.
Sandwich club végé pour moi, petit pain aux lardons pour E. Café allongé et chocolat chaud. Le serveur nous propose de nous installer au fond du bar, sous la télé. Nous nous asseyons sous la fin d’un match de basket aux États-Unis. Les Nuggets ont gagné.
Je passe par les parcs de la ville pour me rendre à la Maison des Écritures. Je coupe par la pelouse, là où l’herbe est piétinée, et je cherche en vain comment on appelle les chemins que les piétons dessinent à force de passages répétés. Le premier que j’emprunte est en cours de formation, le second est pour sa part bien dessiné.
Mon pied glisse sur la terre humide mais je ne tombe pas. Mes semelles lisses n’aident probablement pas.
Je salue Timothé, Ewa, Noëllie, Jul que je ne suis pas sûr de reconnaître, Nohaila dont je me suis exercé à prononcer le prénom.
Je passe une heure avec une poète autrichienne qui écrit un recueil bilingue mais qui n’est pas une traduction.
En sortant, j’ai reçu de nouvelles commandes de boulot. J’ai plein de travail d’un coup, je ne refuse rien. Je me demande si ce sera suffisant pour parvenir à un niveau de salaire acceptable sans chercher d’ateliers.
J’avais presque complètement éradiqué les spams de ma boîte mails, mais mes récents déboires de messagerie ont dû remettre mon adresse dans des circuits foireux, j’en reçois plusieurs aujourd’hui.
Après un « café moderne » et un « bistrot créatif », je note une « table à vivre ».
J’ai le temps d’acheter deux cadeaux, et d’aller payer l’orthodontiste. La femme devant moi prend tout son temps, et même plus.
Les cadeaux m’encombrent, je commence à moins apprécier ma virée en ville.
J’embrasse Émilie. Je salue Laurent. On n’a probablement pas grand-chose à se dire et on ne cherche pas à prolonger l’échange.
Nous sommes contrôlés dans le train. Le contrôleur m’explique que le titre que je lui présente ne lui permet pas de savoir combien de voyageurs voyagent avec moi. Je lui explique que nous ne sommes que deux et que si j’étais seul, j’aurais choisi une autre formule de transport qu’une formule de groupe. Le contrôleur m’explique que le titre que je lui présente ne lui permet pas de savoir combien de voyageurs voyagent avec moi. J’ai envie de lui demander de me prouver qu’il n’est pas un robot.
J’ai une grosse fringale en rentrant et je me fais griller quelques tartines. L’odeur est encore perceptible quand je reviens des courses.
J’épuise le mixer en hachant menu des pois chiches.
Riz et légumes, riz et calamars frits.
18 décembre
Je ne parviens pas à déterminer si j’étais éveillé une bonne partie de la nuit ou si j’ai rêvé que j’étais éveillé une bonne partie de la nuit. Quand le réveil a sonné, j’ai juste eu l’impression réconfortante de pouvoir m’accrocher à une bouée perdue dans le noir.
Je salue Valérie, je salue Pascale.
Je travaille ce matin à mon pensum délibératif mensuel. Je tombe sur un très beau spécimen de bullshit :
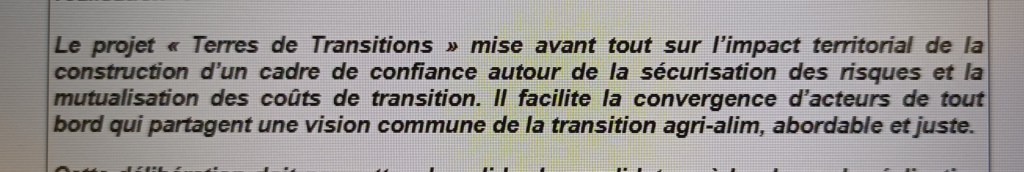
Comme il flotte, nous allons déjeuner dans une crêperie avec E. J’embrasse Nelly et je lui pique sa place. Le patron fait des blaguounettes à chaque passage mais ça reste supportable. 37€.
J’ai une demi-heure à perdre avant mon rendez-vous de l’après-midi. Je traîne en ville mais il fait juste assez froid, ou je suis juste insuffisamment couvert pour que ce ne soit pas très agréable.
Sur la place du marché en train d’être nettoyée, une nuée de pigeons s’en donne à cœur joie sur une brioche abandonnée.
Je m’arrête quelques secondes dans la rue pour reconnaître une odeur : du baume du tigre, ou du camphre, plus simplement. Je suis seul dans la rue, je ne sais pas d’où ça vient.
Aujourd’hui encore, j’ai des chaussures à semelles trop lisses et la ville est réputée pour ses pavements casse-gueule dès qu’il pleut. Je me méfie du moindre changement de trottoir.
Je rencontre Aurélie pour mes articles à rendre début janvier. Elle n’a que des infos très générales à me donner, toutes les décisions devant être prises mi-janvier. Je pense qu’il va falloir négocier un délai.
Je ne retourne pas travailler à la bibliothèque universitaire après mon rendez-vous, je n’ai qu’une heure à attendre. Je m’installe dans un café du port, à proximité de deux dames âgées qui m’offrent un festival de ragots et de commentaires de l’actualité. Je regrette presque de n’être pas assis plus près et de ne pas enregistrer leur conversation. J’ai déjà écrit un recueil de ragots, que j’ai récemment repris et augmenté, mais là, je suis à la source, j’ai du ragot à l’état natif.
Par ailleurs, j’essaie de me concentrer pour avancer sur mon pensum mais la concurrence est rude. A la fin de la journée, j’ai tout de même rédigé près des 9/10e de ce pensum, ce qui était inespéré ce matin quand je m’y suis mis.
Florentine Rey envoie l’avis officiel de lancement de son bouquet d’ateliers d’écriture. On le trouve à l’adresse https://ecriture-en-ligne.fr/ et il y a une erreur dans mon nom. Ce projet de Florentine est la vraie bonne surprise de ces dernières semaines : inattendu, généreux, simple, gratifiant.
Une question : que trouve-t-on derrière la porte de la Direction logistique des moyens généraux ?
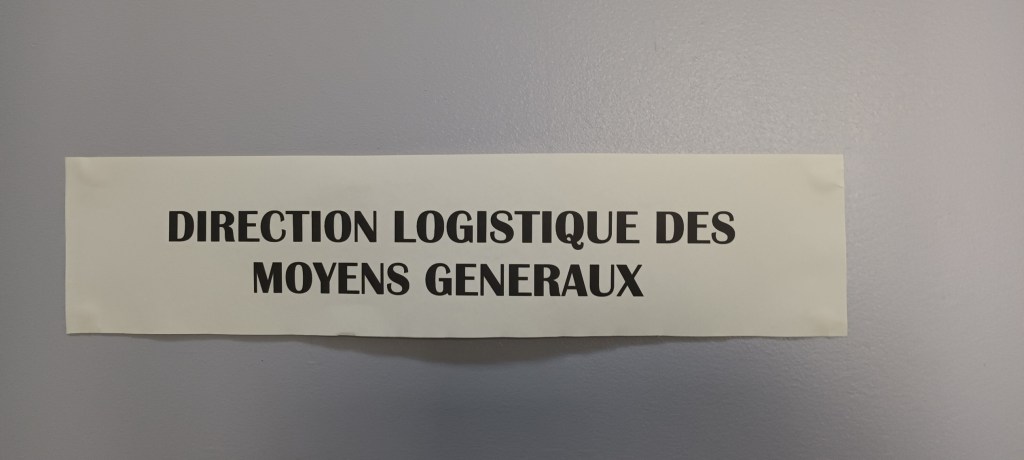
Sur le quai de la gare, je suis intrigué par des tire-fonds qui semblent enfoncés dans le tronc d’un petit arbre d’ornement, avant de me rendre à l’évidence : ces oliviers en pot sont métalliques.
Rien au courrier.
Je cours 49 minutes, de nuit à nouveau, avec ma lampe frontale.
Dîner de flemme : spaghettis et leur farandole de sauces tomate industrielles. Pomme et clémentines.
Il tombe une pluie lourde dans la soirée, de celle qui pourrait bien se frayer un chemin sous le toit de la maison et venir goutter dans le passage entre la cuisine et le salon.
Tenir ce journal se fait aux dépens de mes lectures. J’emprunte et j’entasse des livres que j’ouvre à peine, dans lesquels je picore seulement. Je ne sais pas si je dois le déplorer.
19 décembre
Je suis réveillé par l’alarme de C., mais je peux me rendormir pour une heure. Sauf que C. me réveille parce qu’elle s’inquiète de ne pas pouvoir joindre F., qui a une épreuve ce matin et avait demandé à ce qu’on la rappelle. Finalement, nous parvenons à joindre F. au moment où j’aurais dû me réveiller.
Je ne cours pas aujourd’hui, ni ce matin, ni ce soir.
Je découvre que je peux valider deux billets de transport sur mon carnet virtuel.
Je traverse le bassin du port au moment où la passerelle se lève pour laisser passer quatre voiliers. Pas des beaux voiliers en bois, des camping-boats à voile pour caboteurs friqués, mais il n’empêche, voir défiler des bateaux au petit matin donne une impulsion tranquille à la journée.
J’écris l’édito d’un catalogue d’expo sur l’archipel des Vanuatu. Kamoulox.
Une ligne pleine au Bingo des crevards : pendant que nous mangeons nos sandwichs au soleil, s’alignent devant nous un pigeon, une mouette et une sorte de bécasseau. Sandwich « crétois » pour moi, flute aux lardons pour E., puis far pour moi, et cookie pour E., puis chocolats chauds pour E., R. et moi. Une vingtaine d’euros.
A la table juste à côté de nous, une femme passe un appel dans une langue que je n’identifie pas : polonais ? russe ?
Devant la bibliothèque universitaire, en début d’après-midi, le Père Noël de la banque alimentaire distribue de la nourriture aux étudiants. La file est importante.
Sur la mezzanine où je me suis installé, j’ai l’impression très nette de sentir le sol légèrement trembler. J’essaie d’éliminer tout ce qui est susceptible d’interférer sur cette sensation : j’ai les pieds bien à plat sur le sol, je m’assieds correctement dans le fond de ma chaise, je retiens ma respiration, et je suis bien sûr que le sol tremble légèrement sous mes pieds. Personne d’autre que moi ne semble troublé.
Certains soirs, quand je m’endors, j’ai aussi cette impression de sentir la terre presque imperceptiblement trembler.
Je reçois un mail comportant un appel à candidature pour une résidence d’écriture. Ce n’est pas loin de la maison, ce ne serait pas très exotique, mais le simple fait de se projeter suffit déjà. Peut-on être écrivain en résidence à moins de 20 kilomètres de chez soi ? Pour écrire quoi ?
Les chemins dessinés par l’usage s’appellent des lignes de désir.
De part et d’autre de ma table à la bibliothèque s’installent de jeunes étudiantes qui ont l’air toute discrètes, mais qui se révèlent d’intarissables bavardes. Moi-même, je vais saluer Clémence, qui participait l’an dernier à mes ateliers d’écriture, pour enquiquiner ses voisines avec mes bavardages.
Tandis que j’attends E. sur le parvis de la gare, en essayant de me cacher des courants d’air glacés, le nez dans mon écharpe, la tête rentrée sous la capuche de mon ciré, je compte les jeunes gars en short et en tee-shirt.
Rien au courrier.
Froid + pluie = tartiflette.
20 décembre
Réveil 7h. Lever 7h07.
Nous saluons et voyageons avec Valérie.
Ça sent la colle industrielle, que j’attribue à la présence de chantiers navals dans le quartier universitaire.
Les étudiants installés à côté de moi font des quiz en ligne et s’esclaffent quand l’un d’eux pète. Ce n’est plus une BU, c’est un EPHAD.
Chèvre-tomates séchées et far pour moi, poulet-curry et financier pour E. Nous mangeons en bordure du square, à côté du monument aux marins morts. Nous terminons par deux chocolats chauds. Le client à côté de nous commande une vodka.
Je salue Joffrey. Nous ne travaillons plus ensemble. Je salue Martin, il cherche des cadeaux sans envie ni conviction.
Les mails ricochent d’interlocuteurs en interlocuteurs. Chacun cherche à boucler chaque petite tâche avant ses congés. Dans quelques heures, personne ne répondra plus.
La bibliothèque ferme ce soir pour quinze jours. J’emprunte trois bouquins supplémentaires, dont deux pour R.
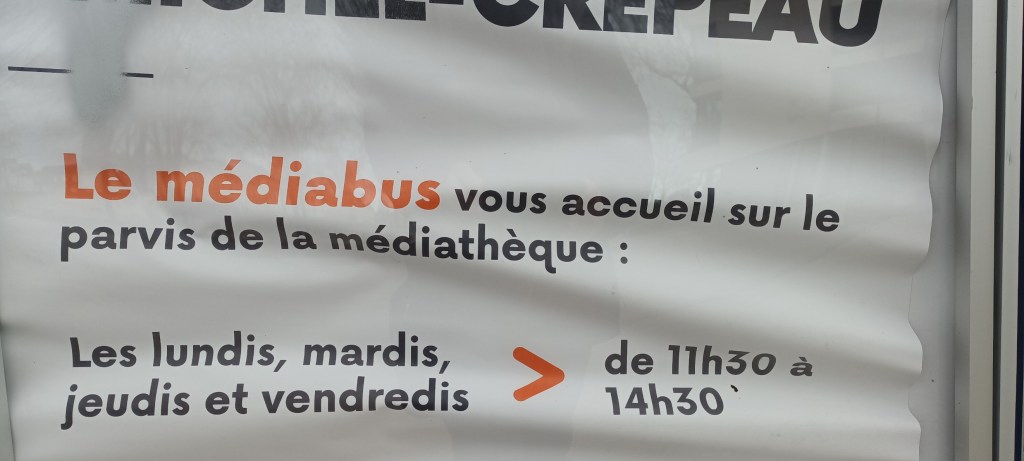
Nous saluons et voyageons avec Pascal, dans un train bondé. Nous parlons graphisme.
Dans la boîte aux lettres, l’offre de service d’une conciergerie pour locations saisonnières, la septième plaie de la ville.
Ma pile d’articles a fondu mais la pile de linge a grossi.
Un des inconvénients de vouloir courir le soir, c’est que la flemme peut être vive, après une journée de travail. Il se met à pleuvoir. L’arrière d’un mollet tire un peu. Je passe mon tour.
Impro sur une base de couscous.
21 décembre
Aucune idée de l’heure qu’il peut-être à mon réveil. J’ai l’impression d’avoir très bien dormi et d’être reposé mais il est peut-être trois heures. Peut-être quatre ? Ou à l’inverse, il est peut-être neuf heures ? 6h54. Je me suis réveillé six minutes avant l’heure programmée de mon réveil habituel. Je suis bien réglé.
Les deux premiers mails du samedi matin : des nouvelles de mon compte retraite et la newsletter de l’URSSAF. Vis ma vie de rêve.
Je cours 1h23. Je pars en automne et je rentre en hiver. Le soleil derrière les nuages dore le ciel et le reflet de la mer dans les vasières d’une lumière orange pâle. J’ai beaucoup aimé mes courses de nuit, mais c’est toujours plus beau au petit matin et les odeurs sont toujours plus prégnantes, comme l’iode ce matin.
J’ai toujours aimé l’idée des changements de saison.
En courant, j’entends les cris furieux d’une mouette, sans la voir. Je réalise en le croisant qu’il s’agit de la sonnerie de portable d’un promeneur.
Je me demandais ce matin où était coincée ma commande de bouquins. Je la reçois au courrier dans la matinée. La factrice nous laisse un calendrier avec un bouvier bernois.
Nous déjeunons des restes de couscous. Je complète avec une grosse assiette de carottes râpées.
Je suis toujours d’une humeur intermédiaire à l’approche des fêtes. Je ne goûte pas particulièrement cette période de rassemblements familiaux et amicaux, et l’avalanche à venir de paroles, discussions, questions… je crois que c’est ce que je redoute le plus. J’arrive maintenant assez bien à résister à la démesure gastronomique et à manger dans des proportions très raisonnables, je bois peu voire plus mais je suis déjà fatigué du monde et du bruit.
Nous retrouvons Julie et Alexander pour un chocolat. Nous saluons brièvement Sylvie, qui est devenue pratiquement aphasique. Puis nous saluons Matthieu et Maud, que nous n’avons pas vu depuis bien dix ans, et leurs enfants qui ont grandi.
Passer le dernier samedi avant Noël en plein centre-ville est une manière pour moi de me préparer aux hostilités à venir. Une sorte de conditionnement zen. Nous entrons dans les boutiques, nous n’achetons pratiquement rien. Je m’aperçois en fin d’après-midi que le paiement de l’application de stationnement n’est pas allé à son terme et qu’en conséquence nous n’avons pas payé. Y aura-t-il des prunes à Noël ? Non. Nous faisons un passage express à la librairie, pour saluer les libraires, éreintés mais nous ressortons sans rien avoir acheté. J’ai déjà emprunté trop de livres que je ne parviens pas à lire, à peine à feuilleter. Écrire, et notamment écrire ce journal, occupe beaucoup du temps que je consacrais auparavant, que je pourrais consacrer aujourd’hui, à la lecture.
Nous dînons d’une soupe et de samoussas.
22 décembre
Je me réveille à 7h12, je me lève à 7h47, après avoir lu deux ou trois articles en ligne (je devrais tenir la liste du premier article que je lis intégralement le matin ; pas juste les titres : l’article, et me demander pourquoi celui-ci. Ce matin par exemple un entretien avec Inés Léraud : « Les blessures psychologiques et sociales du remembrement ne sont pas refermées », puis « Pour ou contre… les stagiaires de 3e ? »)
J’ajoute, dans la liste des listes à faire :
- playlist des chansons parasites
- inventaire photographique des lignes de désir
- liste du premier article lu le matin en guise de réveil
Chanson parasite pendant que je photographie la germination de nos patates-coeur-hommage à Agnés Varda : Face aux mouvements du coeur #1, de Chevalrex.
Lu dans le journal hebdomadaire d’Anne Savelli à propos d’un « cours de méditation en ligne » qu’elle a suivi :
Continuons. Une pensée est faite d’images, dit l’enseignante, de sons, de mots, de phrases, de sensations, de tonalités. Entre deux pensées, le gap, c’est la conscience ouverte (je note). Son interprétation du mot pensée est vaste. Ce n’est pas forcément une construction intellectuelle. C’est une chose éphémère, qui se dissout comme un flocon sur une plaque chaude, dit-elle (je note), ça ne laisse aucune trace. L’enchaînement d’une pensée à l’autre, elle le compare à de la danse et c’est fou, car c’est exactement ce que je cherche à écrire, sur lequel je peine depuis tant de jours. En observant la pensée délibérément, elle diminue, dit-elle encore, car elle ne nous contrôle plus (je note). Il faut la regarder comme on regarde un film (à nouveau, cela résonne extraordinairement, sur le moment). Elle dit encore que la pensée d’il y a cinq minutes n’est plus exactement la même que celle qui se forme, maintenant, quand on cherche à y repenser. À nouveau, c’est ce que tente de dire un de mes personnages…
Je ne sais pas quoi faire de ça (parce qu’a priori, un « cours de méditation en ligne », ça cumule tout pour me tenir à distance) mais « ça me parle » comme on ne dit plus.
J’ouvre au hasard La substistance au quotidien, de Geneviève Pruvost, que j’ai finalement pu emprunter à la médiathèque (et que, compte-tenu de la fermeture d’icelle, je vais pouvoir garder jusque début avril.) Ça semble passionnant, et limpide. Il y est aussi question de remembrement, qui est à ajouter dans la colonne « Passif » des 30 glorieuses. J’associe souvent une lecture à une connaissance à qui je pourrais la conseiller. Dans le cas présent, Franck et Floriane, assurément. C’est une idée, ça : au lieu de se ruiner mutuellement à s’offrir des cadeaux, on devrait juste s’échanger des « intentions de cadeaux », qui témoigneraient de pensées et de considérations mutuelles. Je vais faire ça maintenant.
J’entends le réservoir de la chasse d’eau se remplir par intermittence. C’est un bruit qui impose une réaction immédiate. Je traficote le bitoniau et ça s’arrête. J’aurais pu être plombier.
Je plie le linge d’hier, je lance une nouvelle machine.
Je ne cours pas le dimanche. Je pensais me réveiller avec des courbatures, ou en tout cas, sentir dans mes jambes le poids de ma course d’hier mais non, bien au contraire, plus je cours et moins j’ai mal.
Je cuisine une sorte de tchouktchouka avec des œufs pochés. Je ne sais pas vraiment ce que c’est mais c’est bon.
Ça sent bon le pain d’épices maison dans la maison.
Je lis dans l’après-midi Nord Sentinelle, de Jérôme Ferrari, qui est le premier livre que je lis intégralement depuis bien longtemps.
Je réfléchis chaque année à des vœux originaux à envoyer, j’ai bien des idées, par exemple envoyer par la poste une sélection de ce journal mais j’arrive le nez sur Noël et je n’ai rien fait. Je crois que j’aimerais écrire un « journal d’étonnements », étonnement étant à entendre dans une définition extensive : on peut s’étonner de l’exceptionnel comme du plus banal.
Trois pizzas maison.




