17 novembre
Je cours.
- Un homme au pied du talus de la digue, côté marais, est en train d’ouvrir l’écluse.
- A côté d’une poubelle, un parapluie retourné par le vent.
Je passe une heure en compagnie d’une jeune dramaturge québécoise en résidence.
Moment d’indécision : je ne sais pas si je dispose d’un temps trop long pour rester à traîner en ville avant l’atelier de cet après-midi (d’autant qu’il fait froid), ou si je dispose d’un temps trop court pour rentrer à la maison pour déjeuner, puis repartir. J’opte pour la chaleur, je rentre.
Je termine l’atelier d’écriture commencé la semaine dernière auprès de lycéens. Ce n’était pas joué au début de la séance, mais à la fin, tous les textes sont achevés.
Je découvre Route One, de Sigur Ros, qui résonne évidemment avec un vieux projet d’écriture.
18 novembre
Je cours. C’est la première course de cet automne qui nécessite de s’équiper contre le froid.
Je suis survolé par des oies en formation.
Je passe un peu plus d’une heure en compagnie d’une jeune plasticienne en résidence.
Je fais de premiers essais pour la création d’une affiche qui rende compte des travaux d’écriture de jeunes élèves. Je n’y arrive pas, je bute sur des choses basiques, comme redimensionner une image au format de l’affiche. En réalité, je me rends bien compte que je n’ai pas du tout la tête à chercher une solution. Je suis accaparé de manière sourde par l’hospitalisation critique de ma sœur. Ma capacité de concentration est complètement défaite. Je n’envisage pas de bonnes choses et, en prévision d’une semaine chargée, je réajuste en permanence l’ordre de mes priorités de travail. C’est épuisant.
19 novembre
Je ne cours pas ce matin. J’ai la flemme et il fait mauvais temps. Alors, ce que je lis sur la course chez David Larlet compense très bien :
People are puzzled when they learn that I’ve been running for decades and have no plans to run a marathon.
(…)
De la différence entre la course pour un objectif et de la course comme mode de vie.
Nous nous rendons dans l’après-midi au CHU de Poitiers avec C. et ma mère. Nous retrouvons ma sœur fatiguée, épuisée, lasse, elle qui a toujours supporté ses soins hospitaliers avec beaucoup d’abnégation. L’interne que nous rencontrons ne cherche pas à se montrer optimiste. C’est sans doute ce que l’on attend d’un médecin dans ce genre de situation, qu’il nous dise les choses franchement, mais le non-dit qui subsiste prend toute la place.
Nous rentrons et ramenons ma mère chez elle. En redémarrant la voiture, je constate que nous n’avons plus de feux de croisement, et plus qu’un seul feu de position. Nous avançons dans le noir, et je suis contraint de mettre les pleins phares. Toutes les voitures croisées me font des appels de phare, c’est normal. Je m’en sors finalement en activement les feux de brouillard, c’est un peu n’importe quoi. Nous allons acheter des ampoules juste avant la fermeture de la grande surface automobile.
À peine revenus à la maison, je reçois un appel de l’interne. L’état de santé de ma sœur s’est fortement dégradé depuis notre départ il y a trois heures. Il nous incite fortement à revenir. J’appelle mon autre sœur. Nous nous retrouvons et nous savons très bien ce vers quoi nous allons. Nous devons l’annoncer à ma mère. Elle ne se sent pas la force de nous accompagner au CHU. C. reste à ses côtés. Nous repartons de nuit pour Poitiers. Nous retrouvons notre sœur aînée, en grande détresse, confuse. Nous sommes impuissants, désemparés, bouleversés. Notre présence à ses côtés semble un motif supplémentaire de stress pour elle. Nous ne savons plus où est notre place.
20 novembre
Nous arpentons en pleine nuit le couloir désert d’un service d’oncologie. Nous dormons tant bien que mal recroquevillés sur un fauteuil et un canapé dans un petit salon aménagé pour les familles. La jeune interne nous réveille pour nous annoncer que notre sœur est partie. Elle est la première à nous présenter ses condoléances. Des sentiments mêlés d’hébétude, de lourd chagrin, d’urgence et de soulagement nous parcourent. Nous sommes dépositaires de ce dernier moment et c’est une charge lourde. Nous nous posons des questions qui semblent dérisoires, comme « faut-il rapporter ses affaires maintenant ? » Nous repartons dans la nuit. Je laisse ma sœur conduire sur l’autoroute, j’essaie de dormir un peu.
Je me couche et dors une heure et quart, puis je pars pour une journée d’atelier auprès d’élèves de primaire. Je suis à la fois présent et absent, je laisse les autres intervenants prendre et garder la parole. Mes batteries se déchargent à mesure que passe la journée. Je finis complètement à plat.
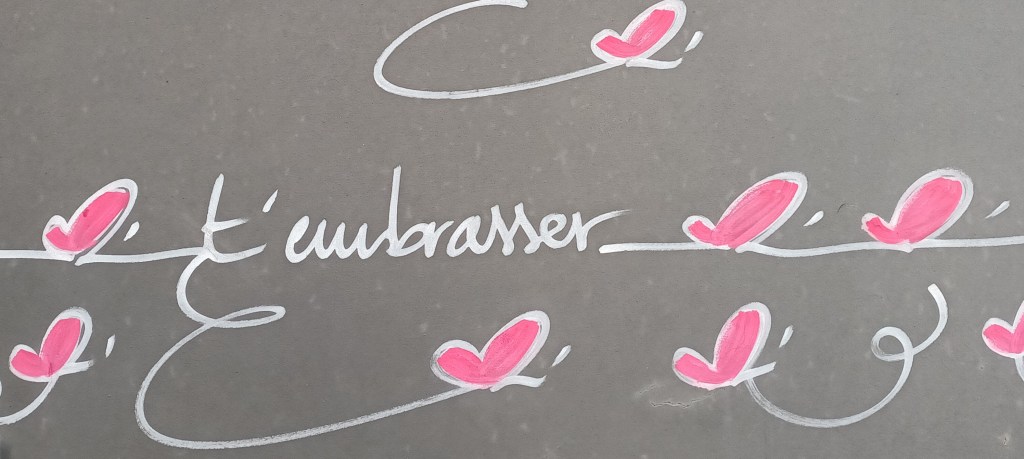
Je remplace les quatre ampoules de la voiture comme un vrai mécano.
On se retrouve en format famille élargie pour partager des pizzas.
21 novembre
C’est difficile d’aller travailler.
Je fais couler un peu d’eau tiède sur le pare-brise givré.
Je descends à pied la promenade littorale jusqu’au lieu de l’atelier. Près de la petite plage urbaine, la police municipale bloque l’accès. Un corps repose sur la promenade, sous une couverture de survie.
Sans que j’ai rien demandé, les profs me proposent de reporter les ateliers de la semaine prochaine.
Ma pizza froide fait drôlement envie aux enfants qui eux mangent majoritairement des chips.
A la pause repas, nous parlons d’écrire des petits messages que l’on pourrait glisser dans nos plats et aliments. Je cherche le nom de ce film où une jeune femme est employée à rédiger de tels messages pour les glisser dans des Fortune cookies. Le titre ne me revient que le soir, c’est Fremont, de Babak Jalali.
La préparation des obsèques commence vraiment, avec son lot de moments improbables, comme choisir les musiques et chansons qui accompagneront la cérémonie et la mise en terre de ma sœur. J’écoute Frédéric François chez le croque-mort. Kamoulox.
22 novembre
C’est le jour où ma chérie à 40 de fièvre,
où ma belle-mère perd les eaux,
où mon fils a 15 ans,
où je passe la journée dans une chambre funéraire.
Je bois tellement peu désormais qu’une seule bière avec mon cousin suffit à me soûler.
23 novembre
Je trouve un peu de temps pour préparer l’atelier de demain, faire les courses pour E., puis je consacre un autre après-midi à attendre à la chambre funéraire des visites de personnes dont je ne connais parfois pas le nom.
